Éditorial – Fédéralisme : quand l’autonomie cache l’ingérence On le présente comme la solution miracle aux crises récurrentes de gouvernance, comme le moyen d’adapter l’État aux réalités locales. Le fédéralisme, ce mot devenu tendance, revient dans les discours politiques avec des promesses d’efficacité, d’équité et de paix. Mais dans l’Est de la RDC, il porte un tout autre parfum : celui d’un piège maquillé en réforme. Et l’histoire nous apprend qu’un idéal mal placé peut servir les intérêts les plus sombres. Prenons garde : le fédéralisme aujourd’hui prôné par le M23 et l’AFC n’a rien de neutre. Il s’inscrit dans une stratégie bien huilée, patiemment poursuivie par le Rwanda depuis près de deux décennies. Déjà à l’époque du CNDP, puis du M23 version 2012, Kigali revendiquait un “couloir de sécurité” dans le Kivu. L’objectif : que cette région frontalière soit administrée et militairement contrôlée par des rwandophones, supposés protéger les intérêts de Kigali contre la menace fantasmée des FDLR. Cette vieille revendication revient aujourd’hui sous un emballage plus sophistiqué : l’autonomie régionale. Mais à qui profite-t-elle vraiment ? À la population locale ? Ou à ceux qui, armés, veulent soustraire ces territoires à l’autorité centrale, en échange d’une paix de façade ? Le Rwanda n’a jamais caché son ambition de voir des officiers favorables à sa cause prendre le contrôle des opérations dans le Grand Kivu. Et le fédéralisme, dans ce cas précis, devient le canal légal d’une influence étrangère durable. L’histoire ne manque pas d’exemples pour illustrer ce danger. Au Liban, dans les années 1970, la logique communautaire et les demandes d’autonomie ont mené à une fragmentation qui a débouché sur une guerre civile sanglante. En Somalie, la décentralisation non maîtrisée a accéléré la balkanisation du pays, chaque région se repliant sur elle-même, parfois au profit de groupes armés. Même la RDC a connu ses propres dérives : en 1960, l’État du Katanga, sous la houlette de Moïse Tshombe, avait proclamé son autonomie avec le soutien de puissances étrangères intéressées par le cuivre. Résultat ? Une guerre sanglante, la mort de Lumumba, et des années d’instabilité. Ce précédent devrait suffire à nous alerter : l’autonomie imposée par des groupes en armes n’est jamais un projet démocratique, mais une opération de prédation. Faut-il rappeler que le fédéralisme, pour être viable, suppose un État fort, une justice impartiale, une culture démocratique enracinée, et surtout une adhésion de toutes les composantes de la nation ? Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Le tissu social congolais est abîmé, la méfiance intercommunautaire est vive, et l’État peine à exercer pleinement sa souveraineté sur l’ensemble du territoire. Dans ce contexte, prôner le fédéralisme sans garde-fou, sans assise institutionnelle solide, revient à ouvrir la voie à des seigneuries locales, dont certaines sont directement téléguidées de l’étranger. Loin de renforcer le Congo, ce fédéralisme-là risque d’en signer l’éclatement. Oui, l’idée d’autonomie provinciale mérite d’être débattue. Oui, la décentralisation peut être un outil de développement. Mais pas à n’importe quel prix. Pas quand elle est dictée par des groupes armés. Pas quand elle répond à une logique d’influence étrangère plutôt qu’à une volonté populaire sincère. La vigilance s’impose. Ce que l’on vend aujourd’hui comme une solution pourrait bien être le début d’un morcellement organisé. Et dans ce piège, c’est la souveraineté nationale qui risque de tomber la première. À méditer, avant qu’il ne soit trop tard.
Actualité
A la une !
2025 © laplumeinfos.net | Tous droits reservés | Designed by Gabriel Ilunga















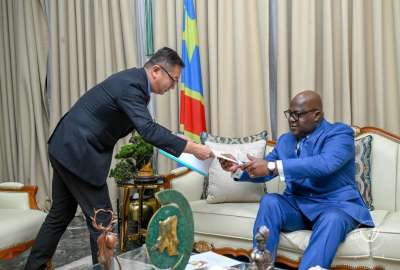



Laissez-nous un message